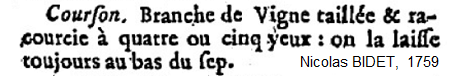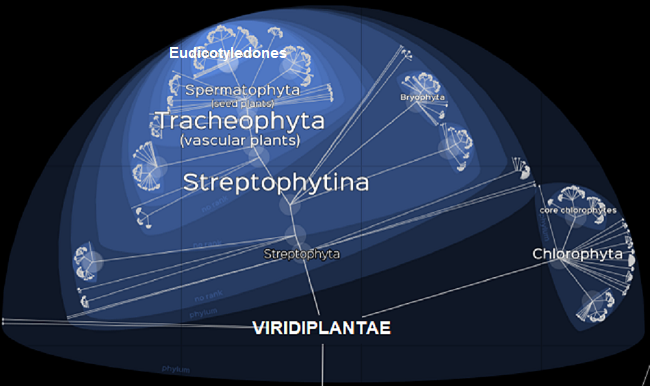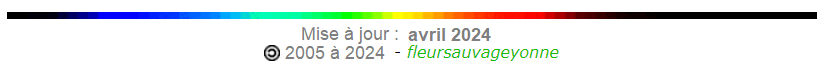Lexique de mots latins
Pour trouver un mot français ou latin, utiliser
- avec un
ordinateur : le
raccourci clavier Ctrl + F
- avec un smartphone sous
Android :
les

du menu de
débordement (
Overflow Menu),
puis "
Recherchez sur la
page"
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A 
Aculeatus, -a, -um
Qui a des piquants, des aiguillons.
Adpressus
Voir appressus.
Adumbrationes
Esquisses, ébauches.
Aera, -ae
Ivraie, mauvaise herbe
Aesculetum, -i (neutre)
Chênaie.
Synonymes : glandaria silva, quercetum.
Ager, agri
Le champ.
Au pluriel : les champs, la campagne.
Agger, -eris
Fossé, remblai, chaussée.
Agrestis, -e
Champêtre, agreste.
Agrostis
Le chiendent.
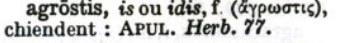
Alata
Portant des ailes.
Albineus, -a, -um
Blanchâtre.
Alburnum, -i
Aubier.
Albus, -a, -um
De couleur blanche.
Voir Couleurs latines pour les couleurs, blanches ou
autres.
Cet adjectif latin nous permet, par association de sonorités, une parenthèse très
botanique à la découverte d'Edmond Albius et de la
vanille.
Alpinus, -a, -um
Originaire des montagnes ou principalement réparti en montagne.
Altrix, -icis
Celle qui nourrit.
Altus, -a, -um
Haut, élevé.
Superlatif altissimus, -a, -um : très haut, très élevé.
Ambrosiacus, -a, -um
Au parfum suave pour Linné, tandis que les Romains
disaient ambrosius, -a, -um, en référence à l'ambroisie de leurs dieux.
Amellus, -i
Une fleur au nom de genre masculin en latin repris par
Linné.
Amoenitas, -atis
Mot de genre féminin en latin : agrément.
Linné nous a fait part de ses Agréments
académiques, 7 volumes regroupant, de 1749 à 1769, les sujets de thèses qu'il proposait
à ses meilleurs élèves qui lui procuraient ainsi de nombreux plaisirs en dissertant, entre
autres, sur le sommeil ou sur les noces des plantes.
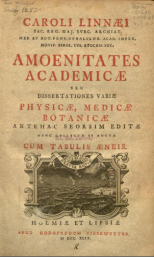
Amygdala, -ae
Amande ou amandier.
Anceps, ancipitis
Qui a deux faces ou deux arêtes saillantes.
Angustus, -a, -um
Etroit, resserré, d'où angustifolius, -a, -um.
Animadversio, -onis
Observation attentive.
Notatio naturae et animadversio, l'étude et l'observation de la nature.
Anserina
De l'oie, en rapport avec les oies.
Cf. Argentina anserina
Apes, apium (plur.), apis, -is (sing.)
Les abeilles. Apes pabulantur, les abeilles butinent.

Apis mane pabulans, une abeille
butinant le matin.
Apiago, apiaginis
Plante recherchée des abeilles citée par Isidore
de Séville.
Apiarium, -ii
Ruche.
Apiarius, -ii
Apiculteur, éleveur d'abeilles.
Apicula, -ae
Petite abeille.
Appressus, -a, -um
Serré contre, couché à plat contre.
Apricus, -a, -um
Exposé au soleil.
Aqua summa
La surface de l'eau.
Arbor, -oris
L'arbre, mot terminé par -or, forme rare en latin, est de genre féminin
(l'arbre étant une mère puisque produisant des fruits), ce qui n'empêche pas les arbres d'avoir
un genre changeant en latin botanique.
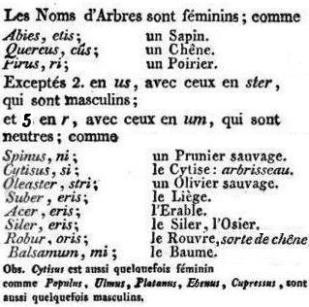
Crebrae
arbores, arbres serrés l'un contre l'autre.
Vitem arboris
appellatione contineri plerique veterum existimaverunt. La plupart des anciens ont
estimé que la vigne est comprise dans le mot arbre.
Hederae quoque et arundines,
arbores non male dicentur. Les lierres et les roseaux aussi ne sont
pas improprement appelés des arbres.
Cf. le Titulus VII, Arborum
furtim caesarum, Des arbres coupés furtivement, dans le Livre 47
(Deuxième partie) du Digeste de Justinien, promulgué en 533 de notre ère.
Arbutum, -i
Arbutum, arbouse, fruit rond de l'arbousier arbutus, -i (mot féminin).
Bacca polysperma tuberculis seminum exasperata comme
l'écrivait Linné.
Synonyme
d'arbutum : unedo, -onis
(qu'on ne mange qu'une fois, selon Pline
l'Ancien).

Baca polysperma
Arbutus, -i
L'arbousier (mot féminin en latin).
Synonyme d'arbutus, le même que celui de son
fruit : unedo, -onis

Paris, Ménagerie du Jardin des Plantes, 21 octobre 2025
Argentinus, -a, -um
Relatif à l'argent (métal), mais en néolatin il signifie : relatif à l'Argentine (un pays
riche de ce métal qui lui a donné son nom).
Arundinaceus, -a, -um
Semblable au roseau.
Arvense, -is
Qui pousse dans les champs, c'est-à-dire dans des terres labourées et cultivées.
Arvum, -i
Terre en labour ou champ.
Arvus, -a, -um
Labourable.
Asepalus, -a, -um
Sans sépales.
Aucupatorius, -a, -um
Qui sert à la chasse aux oiseaux.
Auceps, aucupis
Oiseleur.
Autumnus, -a, _um
Automnal.
B 
Baca, -ae / Bacca, -ae
Baie, fruit rond.
Baccifer, -era, -erum / bacifer
Qui porte des baies.
Bacciformis
En forme de baie.
Bifolia
À deux feuilles.
Binus, -a, -um
Double.
Botaniculus, -a

en même temps que celle de la botanique.
Botanicum, -i
Herbier (chez Isidore de Séville et plus précisément : Botanicum
herbarum).
Cf. Etymologiarum
sive Originum, Liber IV De Medicina - X DE LIBRIS MEDICINALIBVS : Butanicum
(sic) herbarum dicitur quod ibi herbae notentur.
Botryo, -onis
Grappe de raisin. (Mot de genre masculin en latin)
Bruma, -ae
Solstice d'hiver. Hiver.
Brumalis, -e. Brumosus, -a, -um
Qui se rapporte au solstice d'hiver. Hivernal.
Bulbulus, -i
Caïeux.
Bulbus, -i
Bulbe, oignon.
Bullatus, -a, -um
Bosselé, bullé.
C 
Caecus, -a, -um
Aveugle. Privé de lumière, obscur, sombre. Douteux, incertain.
Caedes, -is
Action de couper, d'abattre. Ligni atque frondum caedem facere, abattre bois et
feuillage.
Caedo, cecidi, caesum, caedere
Abattre, briser, fendre, tuer.
D'ou en français le suffixe -cide : fongicide, germicide,
insecticide, molluscicide, nématicide, pesticide, etc...
Linné écrivait odor speciem nunquam clare
distinguit (l'odeur ne distingue jamais clairement une espèce), qu'en est-il de l'odeur
des pesticides ?
Caespes, -itis
Touffe, bourgeon, gazon. Se dit aussi cespes.
Campestre
Adjectif de genre grammatical neutre signifiant "de plaine" et qualifiant l'érable,
Acer, rare nom d'arbre latin de genre neutre mais également, bien
sûr, d'autres végétaux, comme par exemple un Lepidium ou bien l'Eryngium campestre.
Campylus, -a, -um
Courbe, recourbé.
Campylodes
A l'aspect courbe ou recourbé.
Canistra, canistrorum
Paniers, corbeilles.
Cannetum, -i
Lieu couvert de roseaux.
Capillus, -i
Le cheveu. Son diamètre est une unité de mesure employée par Linné qui considère qu'il équivaut
au douzième d'une ligne.
Capreolus, -i
Mot masculin en latin. Vrigne de la vigne. Synonyme de clavicula.
Caudex, -icis
Souche, tronc d'arbre.
Caulias sucus
Suc extrait d'une tige.
Cauliculatus, -a, -um
En forme de tige.
Cauliculus, -i
Petite tige, petite pousse.
Caulis, -is
Tige. (Mot de genre masculin en latin).
Cernuus, -ua, -uum
Qui se courbe ou tombe en avant comme les capitules de Bidens cernua.
Cespes, -itis
Voir caespes.
Chartaceus, -a, -um
Dont la consistance évoque celle du papier, parfois traduit par papyracé alors que l'adjectif
latin papyraceus existe.
Cibus, -i
Sève, nourriture, aliment.
Circinatus
Arrondi, en cercle.
Circulator, -oris
Charlatan.
Cirrhus ou cirrus foliaris
Vrille foliaire... mais la vrille
de la vigne qui n'est pas foliaire se disait
claveolus
ou clavicula
.
Le premier sens de cirrus en latin était
celui de boucle de cheveux.
Citratus, -a, -um
Ayant l'odeur du bois de thuya.
Citriodora
Sentant le citron.
Citrosus, -a, -um
Qui sent le thuya.
Classificatio plantarum
Classification des plantes.
Parmi toutes les classifications existantes ou ayant existé, la
plus connue et donc la plus "classique" est la classification d'abord artificielle initiée par
Linné puis modifiée par la classification naturelle de Jussieu et ensuite mise au point par plusieurs botanistes
"post-darwiniens".
Au XXIe siècle elle tend à être remplacée par celle de l'APG III
dans laquelle Phyllum (ou Divisio) et Classis disparaissent au profit des clades (cladus, -i en
latin).
Ces classifications ne sont donc pas les seules. Elles ne sont pas les premières et
sans doute pas les dernières...
- IMPERIUM
- REGNUM, subregnum
- [PHYLUM, subphylum
ou DIVISIO, subdivisio
- CLASSIS, subclassis]
- ORDO, subordo
- FAMILIA, subfamilia
- TRIBUS, subtribus
(un taxon utilisé pour les sous-familles très
nombreuses
comme par exemple celle des Asteroideae de la
famille des Asteraceae/Compositae)
- GENUS, subgenus
(nothogenus pour les hybrides
)
- SPECIES, subspecies
(nothospecies pour les
hybrides)
- VARIETAS, subvarietas
E.g. (
exempli gratia) :

Tulipa sylvestris L. subsp.
sylvestris
- subspecies : sylvestris
- species : sylvestris
- genus : Tulipa
- familia : Liliaceae
- ordo : Liliales
- [subclassis : Liliidae
- classis : Liliopsida
- phyllum (divisio) : Magnoliophyta]
-
Monocotylédones pour APG III
- regnum : PLANTAE
- imperium : Eukaryota
Clavicula, -ae
Vrille de la vigne.
Clinophyllus, -a, -um
À feuilles penchées.
Coactus, -a, -um
Feutré.
Cognitio, -onis
Action d'apprendre à connaître, étude.
Cognitio contemplatioque Naturae, étude et observation de la Nature.
Color, -oris
Couleur.
En latin, le mot color est du genre masculin... mais en français, ne dit-on pas LE rose
pour LA couleur rose ?
Cf. Couleurs latines
Comans, -antis
Bien fourni.
Comans humus, terre couverte d'herbe.
Communis, -e
Commun, qui pousse partout.
Comosus, -a, -um
Chevelu.
Compactus, -a, -um
Compact ou nain.
Conspectus, -a, -um
Adjectif. Visible, apparent, qui attire le regard.
Conspectus, -us
Coup d'oeil d'ensemble, vue d'ensemble.
Corolla, -ae
En latin classique : petite couronne ou guirlande de fleurs. C'est Linné qui lui a donné
son sens botanique d'enveloppe des étamines et du pistil. Dans ses écrits il l'abrège souvent en
Cor.
Cortex, -icis
Mot de genre masculin. Écorce d'un arbre (arboris), balle (ensemble des glumes ou
glumelles) du blé (tritici).
Corymbosus, -a, -um
À fleurs en corymbes.
Corymbus, -i
En latin classique : grappe de lierre.
Cracca, -ae
Grain de la vesce sauvage.
Crassiusculus, -a, -um
D'une épaisseur moyenne.
Creber, crebra, crebrum
Serré, épais.
Crebra silva, forêt épaisse.
Crebratus, -a, -um
Épais, dense.
Crebrinodus, -a, -um
Plein de nœuds.
Crenatus, -a, -um
Crénelé.
Cristatus, -a, -um
Qui a une crête ou qui est surmonté d'une aigrette.
Crustulum
Friandise. Pluriel crustula. Ce mot signifierait désormais "cookies".
Cucullatus, -a, -um
Qui a un capuchon, comme celui que forme la spathe de l'Arum maculatum.
Culta, -orum
Lieux cultivés, cultures. Cf. son emploi à l'ablatif par Linné : cultis,
dans les cultures.
Curiositas, -atis
Mot féminin en latin. Désir de connaître, soin que l'on apporte à s'informer. Ne pas confondre
avec exploratio.
Custos, -odis
Courson, ou coursonne pour une branche taillée court.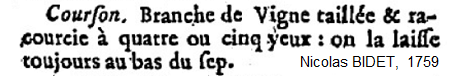
Mais avant tout gardien, comme Pietro Arduino l'était car d'origine sociale modeste. Son ouvrage connu sous le titre abrégé Animadversionum botanicarum specimen le présente comme Veronensis horti publici patavini custodis.
Cynips
Un mot néo-latin forgé par Linné peut-être d'après le mot latin cité dans Le Gaffiot :
 .
.
Si tant est qu'au XVIIIe siècle se lisaient encore Saint Avit ou les Etymologiae d'Isidore de Séville dans lesquelles, au Livre XII De animalibus, sont cités (n'ayant rien à voir avec les moustiques) de Grands boucs appelés cinyphii de la rivière Cinyps en Libye, où ils sont nés grands !
D 
Deciduus, -a, -um
Qui tombe, tombé.
Defixus, -a, -um altis radicibus
Bien enraciné.
Delectus, -us
Choix, discernement.
Sine delectu = au hasard.
Digitus, -i
Petite branche, rameau.
Dilectus, -us
Cf. delectus.
Dioicus, -a, -um
Dioïque.
Disjectus, -a, -um
Dispersé, séparé, disloqué.
Diversifolius, -a, -um
À feuilles variables.
Docens
Enseignant, maître.
Dodrantalis, -e
Qui a neuf pouces de profondeur ou de longueur.
Domesticus, -a, -um
Proche de la maison, domus (un mot féminin bien que terminé en - us).
Dubius, -a, -um
Douteux, incertain.
Dulcacidus, -a, -um
Aigre-doux, aigre-douce.
Dumus, -i
Buisson, hallier.
Dumosus, -a, -um
Couvert de ronces, couvert de broussailles.
E 
Edulis, -e
Bon à manger, qui se mange.
Effusus, -a, -um
Lâche, sans contrainte.
Encheridion
Petit traité, petit manuel, peut-être dirions-nous désormais livre
de poche. S'il s'agit de botanique Encheridion botanicum, car c'est un mot de
genre neutre dérivé du grec ancien έγχειρίδιον (enkheiridion), formé de έν
(en), dans + χείρ (kheir), main + le suffixe diminutif -ίδιον.
Enumeratio, -onis
Mot féminin en latin. Dénombrement.
Erectiusculus, -a, -um
Adjectif linnéen : un peu ou presque dressé(e) comme les fleurs de Scilla bifolia.
Ericetum, -i
Bruyère. Mais également lande, terre aride.
Ex
Une préposition latine souvent utilisée en nomenclature
botanique, non suivie d'un point, ex. étant l'abréviation du mot exemple.
Exaridus, -a, -um
Tout à fait desséché.
Exasperatus, -a, -um
Raboteux, inégal, rude.
Eximius, -a, -um
Qui sort de l'ordinaire.
Exploratio, -onis
Exploration, examen, espionnage.
Exsertus, -a, -um
Proéminent, qui fait saillie.
F 
Faba, -ae
La fève.
Un aliment dédié aux défunts de l'Antiquité romaine que le Flamen
Dialis ne devait pas toucher ! Mais elle fut étudiée par Théophraste
et Pline l'Ancien.
Falcatus, -a, -um
En forme de faux, courbé.
Fastigiatus, -a, -um
Étroit, fastigié.
Fenum, -i
Le foin.
Figura nihili
Zéro.
Filix, -icis
Fougère.
Flavicomus
Qui a les cheveux blonds.
Flora
Flora était une déesse des fleurs
dans l'Antiquité romaine.
 Flora - E. Morricone/Stefano Di Battista
Flora - E. Morricone/Stefano Di Battista
 Le
Triomphe de Flore - R. Gerber
Floricolor, -oris
Qui a l'éclat des fleurs.
Floricomus, -a, -um
Couronné de fleurs.
Floridus, -a, -um
Fleuri, couvert de fleurs.
Florifer, -fera, -ferum / Floriger
Qui porte des fleurs.
Florigenus, -a, -um
Qui produit des fleurs.
Florilegus, -a, -um
Qui choisit les fleurs, qui butine.
Florus, -a, -um
Fleuri, éclatant.
Flos, floris
La fleur, mot du genre masculin en latin, désignait plutôt le suc des fleurs, leur parfum (à
distinguer de leur odeur, ce que Linné avait déjà noté : odor speciem nunquam clare
distinguit (l'odeur ne distingue jamais clairement une espèce).
Le
Triomphe de Flore - R. Gerber
Floricolor, -oris
Qui a l'éclat des fleurs.
Floricomus, -a, -um
Couronné de fleurs.
Floridus, -a, -um
Fleuri, couvert de fleurs.
Florifer, -fera, -ferum / Floriger
Qui porte des fleurs.
Florigenus, -a, -um
Qui produit des fleurs.
Florilegus, -a, -um
Qui choisit les fleurs, qui butine.
Florus, -a, -um
Fleuri, éclatant.
Flos, floris
La fleur, mot du genre masculin en latin, désignait plutôt le suc des fleurs, leur parfum (à
distinguer de leur odeur, ce que Linné avait déjà noté : odor speciem nunquam clare
distinguit (l'odeur ne distingue jamais clairement une espèce).
Des mots latins en rapport avec les fleurs :
-
Flosculus, -i : une (petite) fleur. Sans doute le
mot antique le plus proche du mot fleur en français mais peut-être
abandonné par les botanistes écrivant en latin ?
-
Nucamentum, -i (un mot neutre) : la fleur du
noyer.
-
Pappus, -i : fleur de chardon, un sens différent
de celui du pappus des botanistes
contemporains.
-
Iuli, -orum (ou juli, -orum) : un mot pluriel pour
désigner le chaton du coudrier.
Foemina
Femelle, non pour indiquer le sexe d'une plante mais sa taille inférieure par rapport à une
plante de même espèce qualifiée de mas.
Foetidus, -a, -um
Qui sent mauvais, fétide.
Folium, -ii
La feuille, mot du genre neutre.
Au pluriel, folia, les feuilles.
Folium simplex 
Folia simplicia 
Folium compositum 
Pour décrire une feuille, il faut être méthodique et
s'intéresser entre
autres à
- son pétiole, Petiolus, -i
- sa forme, Forma, -ae
- la marge,
Margo, -inis de son
- limbe, Lamina, -ae et
- sa nervation, etc...
Fornix, fornicis
Pluriel : fornices. Sens botanique, pouvant faire allusion aux autres sens de ce
mot : repli ou languette en forme de voûte dans la gorge de la corolle de certaines espèces
de fleurs dont les Boraginaceae, comme ci-dessous les fornices de Symphytum officinale.

Fragans, -tis
Odorant, parfumé, qui sent bon.
Fragantia, -ae
Odeur suave, parfum. Cf. Patricii Süskind Fragrantia
Frondens, -tis
Couvert de feuilles.
Frons, frondis
Feuillage. Frons est un mot latin féminin que l'on retrouve dans la fronde des fougères.
Fruges, -um
Un féminin pluriel plus souvent employé que le singulier frux, frugis.
Les graminées, les grains, les moissons.
Frutex, -icis
Arbrisseau.
Fruticosus, -a, -um
Buissonneux ou plein de rejets.
Fungarium
Collection de spécimens séchés de macromycètes (Fungi) et de myxomycètes (Amoebozoa).
Furca, -ae
Fourche, bois fourchu, pince des écrevisse.
Furcatus, -a, -um
Adjectif. Fourchu, -e.
G 
Galea, -ae (féminin)
Casque. Ex. linnéen : Corollis galea
glutinosis de la sauge des prés.
Gemma, -ae (féminin)
Bourgeon.
Geniculum, -i / Genu, -us
Noeud (d'une tige).
Genus, -eris
Genre.
Glandarius, -a, -um
Qui produit des glands. Glandaria silva, chênaie.
Glans, -andis (féminin)
Fruit du chêne ou parfois d'autres arbres, gland.
Glareosus, -a, -um
Plein de graviers.
Globosus, -a, -um
Rond, globulaire, sphérique.
Glubtus, -a, -um
Écorcé(e), à l'écorce ôtée, .
Glutinosus, -a, -um
Visqueux, collant.
Glutus, -a, -um
Agglutiné, adhérent.
Glycyrrhiza, -ae
Racine sucrée, réglisse.
Gracilis
Mince, gracieux, grêle, léger.
Gramen, -inis
Gazon. Gramen floreum, gazon émaillé de fleurs.
Chiendent.
Graminosus, -a, -um
Herbeux.
Grandiflora
À grandes fleurs.
Grandiscapius, -a, -um
Se dit d'un arbre dont le tronc est élevé.
Graveolens, -entis
Dont l'odeur est forte.
Gullioca, -ae
Brou des noix (enveloppe verte et coriace).
Gustus, -us
Saveur, goût d'une plante ou d'un fruit.
Guttatus, -a, -um
Tacheté, moucheté.
Guttula, -ae
Gouttelette, petite goutte.
H 
Haustor, -oris
Celui qui puise, celui qui boit. D'où le terme botanique d'haustorium (pluriel haustoria),
organe que l'on retrouve chez Euphrasia
stricta, par exemple.
Herba, -ae
L'herbe. En herbe : in herbis
Herbaria, -ae
La botanique.
Herbarium, -ii
Ouvrage de botanique, mais pas dans le sens du mot herbier actuel, apparu
lui au XVIe siècle.
Cf. Histoire
des herbiers.
Herbarius, -ii
Un herboriste ou un botaniste.
Herbula, -ae
Brin d'herbe
Hiems, hiemis
L'Hiver.
Hircinus, -a, -um
De bouc, en peau de bouc, hircin, à odeur de bouc pour Linné et ses Hircini, des fleurs que l'on
peut donc qualifier de puantes
comme Hypericum hircinum, le millepertuis
androsème.
Hirsutus, -a, -um
Couvert de poils hérissés et apparents.
Hispidus, -a, -um
Hérissé, âpre, raboteux, velu.
Horizontalis
Horizontal et donc rampant.
Hortensis, -e
De jardin, de potager.
Hortus, -i
Jardin.
Hortus siccus
Herbier (jardin sans humidité).
Humidiusculus, -a, -um
Plutôt humide.
Humilis, -e
Bas, près du sol, peu élevé, nain.
Humus, -i
Mot de genre féminin. Sol, terre.
Hypanthium
Un mot latin récent puisqu'apparu vers 1855. Hypanthe (élargissement du réceptacle floral qui entoure alors les étamines,
les pétales et les sépales, et qui souvent protège les fruits en formant un faux-fruit car il
est partiellement obturé.)
I 
Ignotus, -a, -um
Encore ignoré.
Cf. La Lengua
ignota, un lexique trilingue attribué à Hildegarde de Bingen (1098-1179).
Imperium, -i
Domaine.
Incertae Sedis
S'applique à une plante dont la position taxonomique n'est pas certaine.
Indumentum
Pilosité dont la couleur, la densité et la forme des poils peuvent être variables.
Inermis
Sans épine.
Infundibuliformis
En forme d'entonnoir.
In saxosis
Dans les terrains pierreux.
Inventor, -oris
Découvreur, celui qui trouve ; auteur.
Inventrix, -icis
Celle qui trouve ; celle qui crée.
(...oleaeque Minerva Inventrix, ...et toi,
Minerve, créatrice de l'olivier. In Virgile, Les Géorgiques, I, vers
18.)
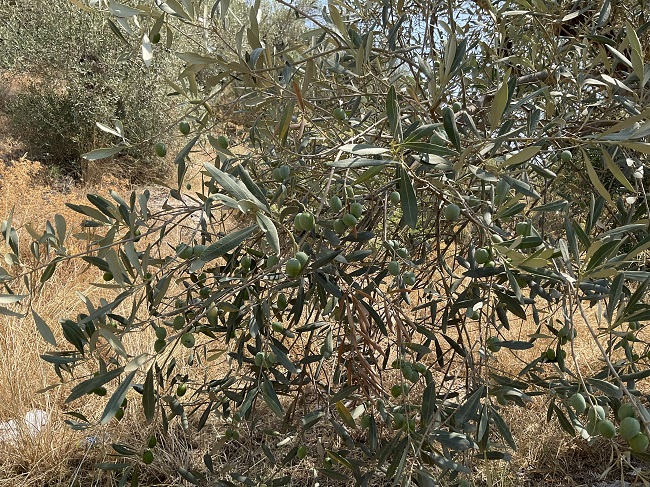
Olea europaea L., 1753
près de Katigiorgis (Agiоs Geοrgios), côte Est dе la
péninsule du Péliоn, Grèce - 6 septembre 2024
dont les fleurs
devaient être aussi belles que celle de la SHHNH
Inversus, -a, -um
Pleureur, qui pend.
Involutus, -a, -um
Enroulé.
J 
Juba, -ae
La cime d'un arbre.
Jucundus, -a, -um
Agréable.
Judicabilis, -e
Litigieux, contestable.
Jugabilis, -e
Qu'on peut unir.
Jugis, -e
Qui coule toujours, jamais tari, inépuisable.
Jugitas, -atis
Écoulement continuel.
Junceus, -a, -um
Semblabe au jonc.
Juxta
Adverbe ou préposition. Côte à côte, ou près de.
Habitat juxta agros et scrobes.
L 
Laciniatus, -a, -um
Finement découpé.
Laevus, -a, -um
Gauche, du côté gauche. On dit également sinister.
Lamina, -ae (féminin)
Le limbe.
Lanatus, -a, -um
Couvert de duvet, duveteux.
Latifolius, -a, -um
À feuille large.
Legumen, -inis
Toute plante à gousses.
Linea, -ae
La ligne, une unité de mesure médiévale encore valide du temps de Linné.
Au Moyen-Age un
grain d'orge mesurait 4 lignes.
Lodex, -icis
Couverture (de lit).
Lodicula, -ae
Petite couverture.
Luteus, lutea, luteum
D'une couleur jaune comme celle du feu.
M 
Maculatus, maculata, maculatum
Taché, tacheté.
Madidus, -a, -um
Humide, mouillé, et parfumé.
Malum terrae
Mot à mot pomme de terre.

Flos mali terrae
Solanum tuberosum, Corbeil-Essonnes, 7 août 2025
Mais c'est une expression qui a servi à désigner diverses plantes (dont l'aristoloche selon Pline l'Ancien, dans le
Tome Second de son Histoire Naturelle, Livre XXV-LIV
[1]).
L'avenue Parmentier parisienne fait "peau
neuve" !
Des fleurs de pomme de terre de la section Petota des
Solanum s'y épanouiront-elles avec des
fleurs de Solanum lycopersicum, la tomate... qui serait son ancêtre d'il y a 8 à
9 millions d'années ?

Flos mali terrae
Solanum tuberosum, Corbeil-Essonnes, 7 août 2025
Pourquoi de ne pas imaginer des Mala lunae ?
 Les
pommes de lune, Evariste
Les
pommes de lune, Evariste
Malus, -i
Nom féminin en latin. Le pommier. Un nom de genre botanique dont les espèces
sont nombreuses !
Mantissa, mantissae
Sens néo-latin : petit addendum, petit complément à un texte publié.
Marginatus, -a, -um
Dont les feuilles vertes sont bordées d'une autre couleur.
Mas, maris
Mâle, non pour indiquer le sexe d'une plante mais sa taille supérieure par rapport aux plantes
d'une même espèce qualifiées elles avec l'adjectif foemina.
Mas est le nominatif et maris le génitif de ce mot qui se
retrouve, par exemple, dans Rhizoma
Dryopteris filicis-maris... des rhizomes un peu dangereux peut-être !
Medicinalis
Adjectif propre au latin botanique indiquant l'usage d'une plante dans la pratique médicale.
Microcarpus, -a, -um
À petits fruits.
Microphylla
À petites feuilles.
Mirabilis, -e
Singulier, étonnant.
Miscellanea, -ae
Mot féminin singulier en latin.
Mélanges (d'écrits).
Mollis, -e
Souple, flexible.
Montanus, -a, -um
Qui pousse dans les lieux en pente. Cf. alpinus.
Muscosus, -a, -um
Moussu.
Mutabilis, -is
Changeant.
Muticus, -a, -um
Émoussé, sans arête.
N 
Nauseosus, -a, -um
Nauséabond, qui cause des nausées.
Cf. Nauseosi : une des catégories d'odeurs
de Linné.
Nemus
Forêt renfermant des pâturages. Nemoralis au génitif
singulier du latin des botanistes (mais nemoris en latin classique).
Nemora, nemorum aux nominatif et génitif pluriels.
Nidiformis
En forme de nids d'oiseau.
Niger, nigra, nigrum
Noir ou qui semble noir.
Cf. Couleurs latines
Nobilis
Bien connu, facile à connaître.
Nodulus, -i
Petit nœud.
nom. cons.
Nomen conservandum = nom conservé dans la nomenclature des taxons en raison d'un usage
très courant, comme par ex. celui de la famille des Gramineae et bien que la règle du Code de
nomenclature soit de donner à une famille un nom bâti sur un nom de genre type inclus
dans celle-ci, dans notre exemple celui des Poa.
Nomen nudum
C'est un nom latin d'espèce de plante sans valeur botanique même s'il existe un échantillon
d'herbier. Est qualifié de nudum le nom donné pour la première fois à un végétal sans
l'avoir décrit dans une diagnose en latin (ou en anglais depuis janvier 2012).
Nomen provisorium
Nom. provis.. Nom provisoire donné par un auteur qui devient finalement invalide mais
ce qui n'empêche pas qu'il puisse devenir nom. cons. par la suite. Un exemple : Leopoldia.
Nomen trivialis
"Nom trivial". C'est ainsi que Linné nommait ses binoms
formés d'un nom de genre et d'un épithète d'espèce.
Nuptiae
Relations sexuelles.
Nux, nucis
En latin classique, tout fruit à écale et à amande (noix mais également noisette, amande,
châtaigne, etc.)
O 
Obsidionalis, -e
Qui concerne le siège d'une ville, un blocus. Dans la Rome antique on donnait une corona
obsidionale au général qui avait fait lever le siège d'une ville.
Occidentalis
D'origine occidentale.
Odor, -oris (masculin)
Odeur, senteur.
Adde nunc uires uiribus,
Dulce balneum suauibus
Unguentatum
odoribus !
Charles Baudelaire
(quand il composait des vers pour une modiste érudite
et dévote)
Cf. Pour une linguistique des
odeurs.
Odoratus, -a, -um (adjectif)
Parfumé, odorant, odoriférant.
Cf. la violette odorante, Viola odorata, la flouve odorante, Anthoxanthum odoratum, l'aspérule
odorante, Galium odoratum, le sceau de
Salomon odorant, Polygonatum odoratum.
Odoratus, -us (masculin)
L'odorat.
L'odeur, l'exhalaison.
Officinale / Officinalis / Officinarum.
Actif, médicinal.
Officinale est un adjectif latin médiéval employé aux
genres :Ses étymologies varient :
- De opificina, dérivé d'ops, opis : le pouvoir, la force. En latin
classique une plante salutaire était dite opifer, opifera, opiferum (portant la
force).
- Ou bien cet adjectif dérive de opifex, un maître dans l’art de faire quelque
chose dont le travail était l’opificina d’où dérive officina, son
atelier qui pouvait être officina chartaria, s’il était papetier, officina
typographica après l’invention de l’imprimerie, ou, plus proche des plantes,
l'officina, c'est-à-dire le laboratoire, où maîtres et compagnons apothicaires,
qui appartenaient à la corporation
des épiciers et dont le métier pouvait être assimilé à celui des droguistes,
concoctaient leur nombreuses préparations pharmaceutiques : décoctions, sirops,
poudres (parmi lesquelles le tabac), thériaques, opiats et autres saulces, tandis que
leur magasin, l'apoticaria, leur permettait de conserver leurs matières
premières parmi lesquelles le sucre dont ils avaient le monopole de la vente.
- Quant à officinarum, c'est tout simplement le génitif (complément de nom)
pluriel du mot officina, des laboratoires.
Olens, -entis
Odorant, odoriférant, mais aussi puant. Se retrouve dans Mentha suaveolens, Ruta graveolens. Compose des adjectifs
comme amoenolens, au parfum agréable, brassicolens, sentant le chou,
melliolens, à odeur de miel. Mais également dans inolens, inodore ou sans
parfum, redolentior, -ius, qui a une meilleure odeur.
Oleraceus, -a, -um
Herbacé.
Olus, -eris
Herbe des jardins potagers, soit considérée comme indésirable, soit cultivée et dans ce
cas : légume ou herbe potagère.
Ordo, -inis
Mot latin masculin ayant le sens de :
- Famille dans la classification du Prodromus
de A.P. de Candolle.
- Ordre dans les classifications
actuelles.
Orientalis
D'origine orientale.
P 
Pabularis, -e
Qui concerne le fourrage (pabulum, -i).
Omnia haec papularia, toutes ces
plantes fourragères.
Palmatus, -a, -um
Découpé comme une main.
Paludosus, -a, -um
Marécageux.
Palustris, -is, -e
Qui pousse dans les marais ou les zones très humides.
Pampinus, -i
Bourgeon de la vigne, pampre.
Paniculatus, -a, -um
Fleur ou inflorescence en forme de cône.
Paribus remotis
Par deux à une certaine distance les unes des autres (en décrivant les fleurs).
Parviflorus, -a, -um
Qui donne de petites fleurs.
Parvulus, -a, -um
Très petit.
Pascua, -orum
Pâturage, pacage, pâture.
Patulus, -a, -um
Étalé, largement déployé.
Peloria
Monstre.
Pauci, -orum
Un petit nombre seulement, quelques-uns (ou quelques unes).
Peltatus, -a, -um
Armé d'un petit bouclier en forme de croissant.
Pendulus, -a, -um
Qui pleure.
Perigynium, -i
Utricule.
Pilosus, -a, -um
Couvert de poils.
Pilosellus, -a, -um
Couvert de duvets.
Pinnatus, -a, -um
Qui a des ailes.
Platiphyllus, -a, -um
À larges feuilles.
Pollex, -icis
Unité de mesure valant actuellemnt 2,54 cm.
Polyspermus, -a, -um
Qui contient un nombre de graines qu'on ne peut compter soit en raison de leur grand nombre,
soit en raison de leur petitesse.
Pomarium, -ii
Verger.
Praecognita (pluriel de praecognitum)
Choses connues ou qui devraient être connues pour comprendre autre chose, connaissances
préalables en sciences.
Praecognitio, -onis
Connaissance préalable.
Pratense, -is, -e
Qui apparaît et pousse dans les prés.
Procumbens
Qui s'étend sur le sol sans s'enraciner.
Pruina, -ae
Gelée blanche, en latin classique. Pruine en néo-latin.
Pruinosus, -a, -um
Pruineux en néo-latin (comme les fruits de Prunus spinosa) ou couvert de givre
(qu'il ne faut désormais pas confondre avec la gelée blanche) en latin
classique.

Herba
pruinosa
Ptarmica
Qui fait éternuer, sternutatoire.
Pulex, -icis
Nom masuculin en latin. Puce, puceron.
Pulicarius, -a, -um
Relatif aux puces. Cf. : pulicaria herba, herbe aux puces.
Pumilus, -a, -um
Miniature, nain.
Pungens, -entis
Piquant.
Pusillus, -a, -um
Tout petit.
Pyramidalis
En forme de pyramide.
Pyxis, -idis
Petite boîte, capsule métallique. Un mot féminin en latin classique et en français devenu en latin botanique
Pyxidium
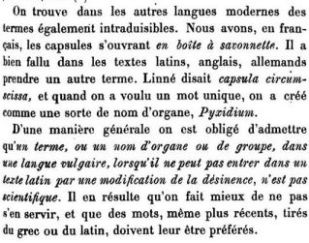
Alphonse DE CANDOLLE in La Phytographie
ou
l'art de décrire les végétaux considérés sous différents points de vue, Paris,
1880.
Q 
Quadratus, -a, -um
Carré. Bien proportionné.
Quercetum, -i (neutre)
Chênaie.
Quercus, -us
Le chêne (un nom féminin en latin).
Et durae
quercus sudabunt roscida mella...
(Et le dur bois des chênes distillera une rosée de miel)
selon Virgile,
dans ses Bucoliques.

Chêne, décembre 2018 - © Claire Martin-Lucy
Quernus, -a, -um
De chêne. Ex. : foliis quernis, à feuilles de chêne.
Quinarius ou quinatus, -a, -um
Qui contient ou qui est formé de 5 articles. Ex. : folium quinatum, feuille à 5
folioles.
R 
Racemosus, -a, -um
À fleurs en grappes.
Racemus, -i
Grappe de raisin.
Radix, -icis
Racine.
Ramunculus fructiferus
Brindille.
Ramus, -i
Branche. Ce mot latin a donné "rain" en ancien français, mot avec lequel on a formé rainceau,
devenu rinceau (branche munie de ses feuilles, en héraldique).
Ranunculus
Grenouillette.
Ratio operis
Manière de travailler ou manière de l'ouvrage (selon le contexte).
Rectus, -a, -um
Droit (horizontalement ou verticalement).
Regalis
Royal, de roi.
Regius, -a, -um
Digne d'un roi, princier, magnifique.
Regnum, -i
Règne.
Repens
Rampant, se tenant au ras du sol, qui s'enracine.
Reptans
Qui rampe en s'enracinant.
Res herbaria
La botanique.
Restibilus, -a, -um
Qui est cultivé tous les ans.
Habitat in agris restibilibus.
Reticulatus, -a, -um
Qui ressemble à un filet.
Rhombeus, -ea, -eum (ou rhombicus ou rhombiformis)
Ayant la forme d'un losange.
Rhomboidalis, -e
Cf. les feuilles de Campanula
rhomboidalis L., 1753
Rhombus, -i
Losange.
Ripa, -ae
Rive, rivage, côte.
Risus sardonicus
Rire sardonique.
Rorata tellus
Terre humide de rosée.
Rorulentus, -a, -um
Humide de rosée.
Ros, roris
La rosée. Un mot de genre masculin en latin : il s'agit d'UN liquide qui dégoutte, qui tombe
goutte à goutte.
Ros solis, la
rosée du soleil.
 Comme le scintillement d'une perle de rosée au soleil par une belle matinée d'été
Comme le scintillement d'une perle de rosée au soleil par une belle matinée d'été
Rued Langgaard (1893-1952), L’Harmonie des Sphères, pour orchestre avec choeur BVN. 128
Roscida pruina
Rosée du matin.
Roscidus, -a, -um
Couvert de rosée.
Rudus, -eris
Pluriel : rudera. Décombre, remblais, ruine.
Rupes, -is
Paroi rocheuse.
Fissuris rupium, dans les fissures des parois rocheuses.
S 
Saccharum
À sève sucrée.
Saepes, -is (= sepes, chez Linné)
Haie, clôture.
En botanique, on trouve souvent ce mot au génitif pluriel :
sepium.
Ex. : Calystegia
sepium.
Saetiger, -era, -erum
Hérissé de soies.
Saltus, -us
Région de bois et de pacages.
Sapor, -oris
Mot masculin en latin comme le goût. Saveur caractéristique de quelque-chose. In ore
sapor, goût dans la bouche.
Sativus, -a, -um
Semé, cultivé.
Satorius, -a, -um
Qui concerne les semailles.
Scaber, -bra, -brum
Hérissé, rude au toucher.
Scandens
Grimpant.
Scapus, -i
La tige (mot masculin en latin). Scapo nudo, à tige nue.
Scrobis, -is
Trou, fosse. Creux sur chaque côté de la tête ou du rostre de certains insectes.
Juxta
scrobes.
Seges, -getis
Mot féminin en latin. Champ de céréales, moisson, récolte de plantes diverses.
(In
segetem spicas fundere = perdre son temps. Mot à mot : répandre des épis dans un
champ de blé)
Sagetalis, -e
Qui croît parmi les blés.
Semen, -minis (neutre)
Synonyme linnéen : sperma. Semence, graine. Au
pluriel : semina.
Semperflorens
Toujours en fleurs.
Sempervirens
Toujours vert.
Sensu
Manière de concevoir.
Sensu lato (s.l.) : au sens large.
Sensu
stricto : au sens strict.
Ces deux expressions peuvent également s'écrire
lato sensu et stricto sensu.
Sepes, -is
Voir saepes.
Sequax, -acis
Visqueux.
Serotinus, -a, -um
Tardif, tardive. Qui vient tard.
Serratus, -a, -um
Dentelé.
Serrulatus, -a, -um
Denticulé.
Siccus, -a, -um
Sec, sans humidité.
Silva, -ae
Forêt, bois. Bosquet, parc
Silvaticus, -a, -um
Qualifie un végétal sauvage (pas forcément des bois ni des forêts). S'écrit également
sylvaticus.
Silvestris, -is, -e
Boisé, forestier ; qui vit dans les forêts ; qui appartient aux forêts. Silvestris
umbra, l'ombre des forêts.
Silvestres saltus
Pâturages boisés.
Silvosus, -a, -um
Boisé, touffu.
Sinensis, -is, -e
Originaire de Chine. 這首曲和诗詞太美了你一定要聽!
這首曲和诗詞太美了你一定要聽!
Sinister, -tra, -trum
Gauche, du côté gauche. On dit également laevus.
Sinus, -us
Courbure, plis, échancrure.
Sordide
Adverbe indiquant une couleur terne, paraissant mêlée de noir ou de bistre.
Spectabilis
Magnifique, spectaculaire.
Sperma, -atis
La graine, le pépin (mot de genre neutre en latin).
Spica, -ae
Épi (mot féminin en latin). Spica mutica, épi sans barbe
Spicatus, -a, -um
À fleur en épi.
Spicilegium
Glanage.
Spinosus, -a, -um
Épineux.
Spurius, -a, -um
Bâtard ; faux, supposé (Caryophyllus spurius inodorus).
Squalidus, -a, -um
Âpre, hérissé, rugueux.
Squamatus, -a, -um
Qui porte des écailles, généralement sur les tiges.
Squarrosus, -a, -um
Rugueux, rugueuse.
Stamen, -inis
Filament, étamine (mot de genre neutre en latin).
Stamineus, -a, -um
Filamenteux (en parlant du bois).
Stirps, stirpis
Souche, racine. Au pluriel (dont le génitif pluriel est stirpium), plantes.
Stramen, straminis
La litière (mot de genre neutre en latin).
Strigosus, -a, -um
Efflanqué.
Stypticus, -a, -um (ou stipticus)
Astringent. Qui resserre.
Sublucidus, -a, um
Faiblement éclairé.
Sublustris, -e
Ayant un faible éclat.
Subluvies, -ei
La boue, la vase.
Subnutans
Légèrement penché.
Subrotundus, -a, -um
Arrondi.
Surculosus, -a, -um
Ligneux.
Surculus, -i
Drageon. Bouture. Écharde.
Sylvaticus
Voir silvaticus.
Sylvestris, -is, -e
Qui pousse dans les forêts. Qui est sauvage, non cultivé.
T 
Taeter, -tra, -trum / Teter, -tra, -trum
Qui affecte désagréablement les sens. Repoussant, affreux, horrible.
Cf. Teter
odor, l'odeur repoussante et la catégorie des Tetri de Linné
Taxifolius, -a, -um
À feuille d'if.
Tegmen, -inis
Un mot de genre neutre en latin. L'enveloppe du grain, mais aussi tout ce qui sert à protéger,
comme patulae tegmine fagi, le vaste couvert d'un hêtre du dernier vers des Géorgiques de Virgile.
Temptamen, -inis ou tentamen. Temptamentum, -i
Essai, tentative. Ex. Tentamen florae germanicae de Roth.
Tenuis, -e
Mince, fin, grêle, étroit.
Tenuis aqua, eau claire. Tenues pluviae,
pluies fines.
Termini artis
Limites d'un art, ce qu'était la médecine et d'autres sciences comme l'ornithologie
au XVIIIe siècle.
Ternarius ou Ternatus, -a, -um
En triple. Folium ternatum, feuille ayant trois folioles sur un pétiole commun, comme
la feuille de Trifolium repens, par ex.
Teres, teretis
Arrondi.
Terna
Folia terna, feuilles réunies par trois.
Tinctorius, -a, -um
Qui sert à teindre, tinctorial.
Tomentum, -i
N'importe quoi et tout ce qui serre à rembourrer.
Torosus, -a, -um
Charnu, épais, noueux.
Tricolor
Tricolore et principalement vert, blanc ou jaune, et rose.
Trilobum
Avec des feuilles à trois lobes.
Triqueter
Qui a trois arêtes.
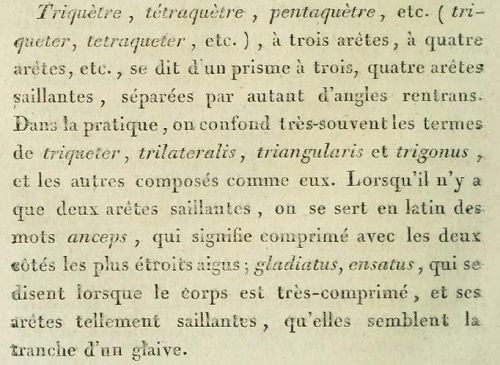
A.P. de
Candolle, Théorie élémentaire de la botanique, 1813
Tristis
De couleur triste.
Tuberculum, -i
Petite saillie, petit gonflement.
Tuberosus, -a, -um
Rempli de proéminences, plein de bosses.
Tumidus, -a, -um
Enflé, gonflé.
Tyro, -onis
Terme qui s'écrivait tiro en latin classique et que Linné utilise pour
désigner le débutant en Botanique dans son ouvrage Philosophia botanica.
U 
Udus, -a, -um
Chargé d'eau, saturé d'eau, humide.
Ex. : Uda humus, terre trempée
d'eau.
In nemoribus udis, dans des bois humides.
Ulcus, -eris
Écorchure d'un arbre.
Uliginosus, -a, -um
Plein d'humidité, marécageux.
Ulmeus, -a, -um
D'orme, de bois d'orme.
Umbellatus, -a, -um
En ombelle.
Mais cette adjectif spécifique peut être trompeur car il qualifie parfois des
fleurs dont l'inflorescence est en corymbe ou en panicule.
Uncia, -ae
Douzième partie d'un tout (qui peut être un pouce, une coudée, un arpent, une livre, etc...)
mais qui pour Linné valait le diamètre ou la dernière phalange de son pouce.
Undulatus, -a, -um
Dont les feuilles sont ondulées ou en vagues.
Unedo, -onis
Synonyme d'arbutum.
Unguis, -is
L'ongle, une unité de mesure linnéenne valant un demi-pouce (soit environ 1,27 cm actuellement).
Urbanus, -a, -um
En parlant d'une plante : cultivée, bien soignée.
V 
Valvulae, -arum
Mot pluriel en latin pour la gousse, la silique, la cosse.
Variegatus, -a, -um
Panaché.
Vegetabilia
Terme latin linnéen. Les Végétaux.
Vegetabilis, -e
Adjectif latin linnéen dans le sens de végétal (Regnum vegetabile), alors que
classiquement il signifiait vivifiant.
Ver, -is
Le printemps
Vernaculus, -a, -um
Qui est du payx, indigène, national.
Vernaculus sapor
Saveur du terroir.
Vernalis, -is ou vernus, -a, -um
Printanier, du Printemps.
Verticillatus, -a, -um
À deux ou trois feuilles partant du même point.
Verum, -i
Le vrai, la vérité, le réel (adjectif verus, -a, -um, employé comme un nom).
Verus, -a, -um
Véritable. Vera causa = preuve incontournable.
Vexillum, -i
Étendard des Fabaceae.
Viciarius, -a, -um
Relatif aux vesces.
Villosus, -a, -um
Velu, couvert de poils.
Virgea, -orum
Branches flexibles.
Virgetum, -i
Oseraie.
Virgulta, -orum
Broussailles,ronces. Boutures, jeunes pousses.
Virgultus, -a, -um
Couvert de broussailles.
Viridarium, -ii
Bosquet, lieu planté d'arbres, parc.
Viridiplantae
Plantes vertes.
Au XXIe siècle, il s'agit d'un clade d'organismes eucaryotes (algues vertes surtout
aquatiques et plantes terrestres initialement sorties de l'eau).
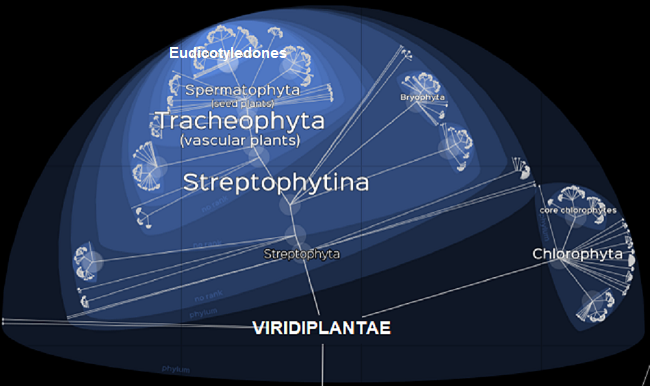
© Lifemap
Vitta, -ae
Bandelette, poche sécrétrice allongée propre au péricarpe (paroi du fruit) des Apiaceae.
Vocabula vernacula
Termes de la langue nationale.
Vulgare, vulgaris
Commun, commune. Ordinaire, banal(e). Qui pousse un peu partout.
Vulnus, -eris
Blessure, plaie, d'où vulnerarius, -a, -um = relatif aux blessures.
Z 
Zebrinus
Rayé, zébré.
Zygis, -idis
Serpolet sauvage.
Zyzyphum, -i
Jujube, fruit (de genre grammatical neutre).
Zyzyphus, -i
Jujubier, arbre (de genre grammatical féminin).
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Le latin utilisé par les botanistes pour nommer les plantes est un peu
particulier, mais vous pourriez l'apprendre sans
peine, même si ce latin reste proche du latin classique en ce qui concerne
la grammaire, la syntaxe et le vocabulaire...
Pourtant,
il ne faut pas oublier que le latin que nous connaissons fut latin classique, latin tardif
(variant du IIIe au IVe siècles) et qu'il devint Roman puis Ancien français, français classique
et qu'il est toujours présent dans la langue franglaise du XXIe siècle.
Souvent des mots
grecs sont également utilisés car ils sont considérés comme latins par le Code de
Nomenclature International (ICN) International Code of
Nomenclature for algae, fungi, and plants
(Shenzhen Code, 2018).
Et comme nous aimons l'Histoire de la Botanique, vous trouverez
également, ci-dessus, quelques mots latins utiles dans ce domaine.
Le latin, une langue inutile
(Cf. Vive le
latin :
histoires et beauté d'une langue inutile de Nicola Gardini,
anciennes
Ed. de Fallois, mai 2018)
mais utile aux botanistes
avec ses noms de
couleurs Latini colores,
ses termes géographiques et d'autres petits mots.
 Un
peu de botanique, Pascal HENI
Un
peu de botanique, Pascal HENI
Omnibus semitis Scientiam botanicam pervenitur
Est Fleurs sauvages de l'Yonne et d'ailleurs
Inventio
silvaticorum agrorumque florum Icaunae in Burgundia,
Lutetiae Parisiorum et Augustobonae in
Gallia
Liens intéressants ou amusants :
Qu'est-ce qu'un lemmatiseur ?
Un lemmatiseur est un outil terminologique utilisé par les traducteurs.
C'est un programme (cf. Collatinus) de traitement
automatique du langage qui permet de passer d'un mot portant des marques de flexion (pluriel,
forme conjuguée d'un verbe, modifications morphologiques dues à la déclinaison...) à sa forme de
référence (lemme ou forme canonique, c'est-à-dire : forme la plus simple utilisée comme
entrée dans les dictionnaires).
En français, la forme canonique (ou forme racine) d’un adjectif est au masculin singulier. En
latin, la forme canonique des noms et des adjectifs est celle de leur nominatif singulier...
En français, la forme canonique d’un verbe est l’infinitif mais en
latin c'est plus compliqué, l'infinitif n'apparaissant qu'à la
fin de sa présentation dans un dictionnaire.
Un exemple avec le verbe
careo, carui, cariturus, carere
qui signifie : ne pas avoir,
manquer de, comme dans
Semina membranula carent de Luzula
sylvatica, la luzule des bois.
La lemmatisation est donc une analyse lexicale qui permet de regrouper les mots d'une même
famille ensemble : c'est un regroupement par lemme.
Mais la lemmatisation a des limites car les lemmatiseurs peuvent ne pas être en mesure de gérer
des mots ayant plusieurs significations ou plusieurs sens : un exemple botanique avec «
rose » ni de capter les nuances et les émotions de certains mots. Ils ne peuvent pas traiter des
mots d'argot, des abréviations ou des néologismes. Des langues ayant une morphologie et une
syntaxe complexes, comme l’arabe, le turc ou le finnois ne seraient pas lemmatisables.
Mots latins par ordre alphabétiqueCouleurs latinesPetits
mots latins utilesTermes géographiques latins

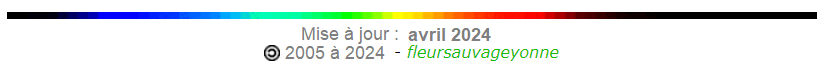
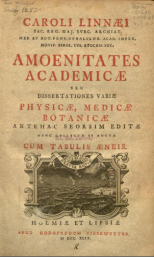

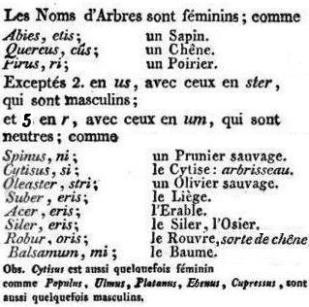




 .
.

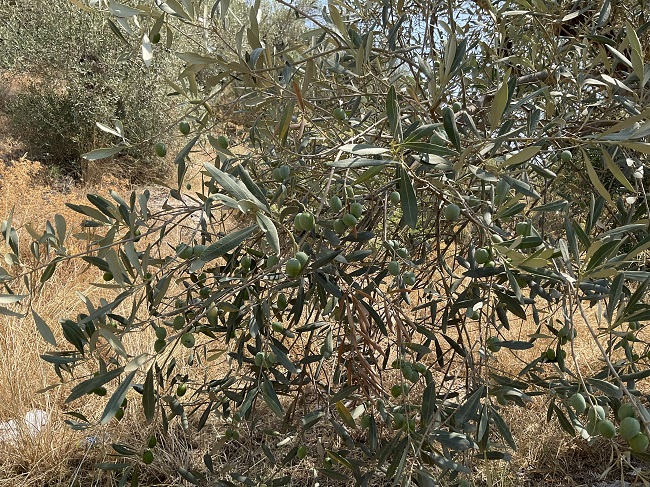


![]() Les
pommes de lune, Evariste
Les
pommes de lune, Evariste

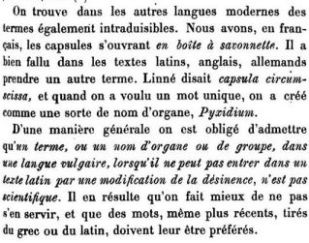

![]() Comme le scintillement d'une perle de rosée au soleil par une belle matinée d'été
Comme le scintillement d'une perle de rosée au soleil par une belle matinée d'été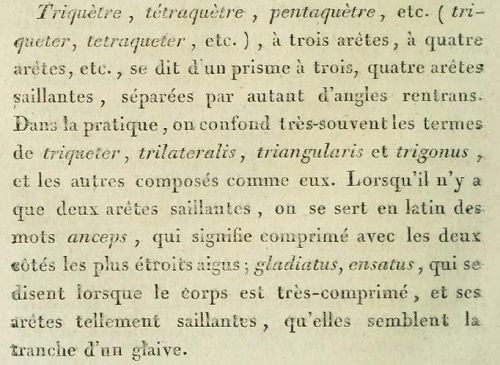
![]() Un
peu de botanique, Pascal HENI
Un
peu de botanique, Pascal HENI