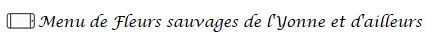Dans l'Yonne
- Très commune.
- Mode de vie : vivace.
- Période de floraison approximative :
Juin-Juillet-Août.
- Habitat : Haies, bord des bois, surtout sur sol calcaire.
- Tailles :
 2 à 6 mètres 2 à 6 mètres  2 cm. 2 cm.
- Port : lianescent.
Origine supposée des noms
- générique : du grec ancien κλημα (cléma), sarment, les clématites ayant des tiges sarmenteuses, c'est-à-dire longues, flexibles et grimpantes comme celles de la vigne. Mais Linné, tant dans son Hortus Cliffortianus que dans son Species plantarum, n'a fait que reprendre le terme utilisé par Caspar Bauhin, κληματιτής ou CLEMATIS, à la page 300 de son Pinax theatri botanici.
- spécifique : contraction des mots latins vitis et alba, vigne blanche.
- Dans l'Yonne (Tonnerrois), cette clématite est couramment nommée "viorne" bien qu'elle ne fasse pas partie de la famille des Viburnaceae.
- Son nom vernaculaire d'herbe aux gueux est sans doute dû au fait qu'en médecine traditionnelle c'était une des espèces du genre Clematis utilisée pour traiter les cloques et comme cataplasme pour purifier les plaies et les ulcères... et non pour se les créer "et exciter la commisération" comme l'avait écrit au XIXe siècle un pharmacien nommé François Dorvault (1815-1879) à la page 204 de son ouvrage intitulé L'officine ou répertoire général de pharmacie pratique dans lequel il indique par ailleurs, page 609, que le "suc" d'Onopordum acanthium "passe pour être utile dans le cancer de la face ; on en imbibe la charpie destinée au pansement".
Détails caractéristiques

- Pouvant être très irritante pour la peau, elle est considérée comme potentiellement dangereuse en cas d'ingestion éventuelle.
Ses feuilles sont inscrites sur la liste B de la Pharmacopée française des plantes médicinales utilisées traditionnellement, en l'état ou sous forme de préparation, dont les effets indésirables potentiels sont supérieur au bénéfice thérapeutique attendu.
Dans les campagnes du Tonnerrois, les enfants (qui la nommaient "viorne") coupaient, dans ses tiges ligneuses, des ''cigarettes'' qu'ils fumaient parfois jusqu'à en vomir..., selon le témoignage d'un homme né en 1934. Mais ses usages peuvent être autres car son bois, très agréable à toucher, peut être sculpté ou vanné.

Photo © Edith Lounès - Début novembre 2010
- C'est une liane très polymorphe et plus ou moins ligneuse qui grimpe grâce aux pétioles de ses feuilles qui sont hypersensibles et s'enroulent spontanément puis changent totalement d'aspect, comme l'avait remarqué Darwin qui a toujours été observateur des variations subtiles mais continues au sein de ces populations que sont les espèces, mais il n'est pas le seul.
Avant lui, Michel Adanson (1727-1806) et, en même temps que lui, Alfred Russel Wallace (1823-1913) dans son article De la tendance des variétés à s'écarter indéfiniment du type primitif en avaient fait autant, et sans doute beaucoup d'autres botanistes.
 
- La souplesse de ses tiges dont le système vasculaire a une extraordinaire capacité de conduction de l'eau. Vue au microscope, leur structure est à la fois complexe et très esthétique.
- Ses feuilles sont opposées (une exception chez les Ranunculaceae).

Tonnerre, 16 août 2022
Fleurs arborant leurs étamines pétaloïdes et feuilles opposées
- Ses fleurs, dialycarpellées, ne présentent pas toujours quatre sépales pétaloïdes que les botanistes nomment tépales et qui sont poilus sur leurs deux faces.

- Leurs étamines pétaloïdes, au nombre indéfini, peuvent être stériles ou à anthères extrorses dont le tapetum présentent des orbicules (ou corps d'Ubisch) et dont les grains de pollen sont de petite taille et attirent plusieurs genres d'insectes pollinisateurs.

- Leurs styles accrescents deviennent les arêtes plumeuses de ses fruits, des akènes qui, portés par le réceptacle floral, forment un polyakène.


Tonnerre, 16 août 2022
Rameaux florifères en cymes bipares débutant leur infrutescence

Tonnerre, 16 août 2022
Nombre d'espèces icaunaises dans le genre
|