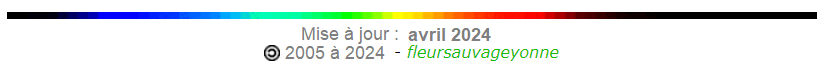Cécidies ou galles
Cécidies ou galles
Causées par des acariens dits galligènes (gallicoles ou cécidogènes) ou des insectes (Hemiptera ou Hymenoptera) :
ACARIENS
 | Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857), la "galle cornue" du tilleul |
HEMIPTERA
 | Eriosoma lanuginosum (Hausmann, 1802) la galle de l'orme, un membre de la super-famille des Aphidoidea à ne pas confondre avec E. lanigerum (Hausmann, 1802). |
HYMENOPTERA
 | Cynips longiventris (Hartig, 1840) le Cynips des galles striées du chêne. |
 |
Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758) le Cynips des galles-cerises du chêne. |
 | Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) le Cynips du rosier, provoquant une galle nommée bédégar ou bédéguar. |
 | Liposthenes glechomae (Linnaeus, 1758), provoquant une galle du lierre terrestre |
Les galles végétales ou cécidies sont des formations "fascinantes" car, entre autres raisons, chacune des espèces conduisant à leur formation produit une structure anatomique morphologiquement spécifique et souvent très complexe pouvant ressembler à des fruits secs ou charnus, à un amas de filaments poilus ou à d'autres structures anormales que l'on qualifie de morphoses.
Cité par C. Souchon, un médecin, botaniste et sinologue allemand, Chrétien Mentzel (1622-1701) affirmait, en 1665, qu'un bédéguar est un "petit édifice dans lequel est engendré une espèce de guêpe".
En 1675, Malpighi (1628-1694) écrivait déjà, en latin, dans son Anatome plantarum :

[...] que les galles ne sont qu’une espèce de nid pour l’œuf ou le ver, lequel vient toujours d’un parent-animal, jamais d’une plante.[...]
Réaumur (1683-1757) a même regretté de ne pouvoir faire certaines observations de Malpighi, lui qui a été un des premiers à effectuer une véritable étude à leur sujet dans ses Mémoires pour servir à l'étude des insectes publiés de 1734 à 1742.
En France, 1500 galles différentes ont déjà été répertoriées.
Selon les organismes qui les provoquent, on distingue :
- bactériocécidies dues à des bactéries,
- mycocécidies dues à des champignons,
- algocécidies dues à des algues,
- zoocécidies dues à des piqûres et à des pontes de femelles d'insectes dits "gallicoles", pour le plus grand bénéfice de leurs larves.
Ces acariens et insectes gallicoles, Hémiptères, Hyménoptères ou autres, qui sont la cause des galles, provoquent une réaction du tissu végétal qui se met à proliférer très vite en modifiant la taille et le nombre de ses cellules et en formant une excroissance dont la forme et la couleur permettent d'en identifier le responsable.
D'autres commensaux ou parasites peuvent occuper également certaines de ces cavités larvaires.
Tous les organes végétaux peuvent être atteints mais ce sont le plus souvent les feuilles, les tiges et les bourgeons qui le sont.
Dans l'Yonne, les chênes avec leurs noix de galle, les épicéas communs avec leurs galles en "ananas" nommées chermès de l’épicéa dues à un puceron (Sacchiphantes viridis), les ormes, et les rosiers des chiens (Rosa canina) avec leurs bédéguars vous permettront de les découvrir.
Il ne faut pas confondre les galles avec les mines, galeries forées dans l'épaisseur d'une feuille par des insectes dits mineurs, ni avec les virescences florales qui sont des anomalies consistant en un verdissement d'un organe habituellement non vert sur une fleur ou encore avec les phyllodies et les fasciations.
| Pour en savoir plus : |
|