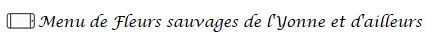Dans l'Yonne
- Commun.
Il en existerait également une variété : Papaver rhoeas var. strigosum Boenn., 1824 dont les poils seraient appliqués sur le pédoncule floral.
- Mode de vie : annuel.
- Période de floraison approximative :
Mai-Juin-Juillet-Août.
- Habitat : Cultures (c'est une plante messicole considérée comme adventice au sein des cultures), friches.
- Tailles :
 20 à 60 cm 20 à 60 cm  70 à 100 mm. 70 à 100 mm.

Blannay, 12 mai 2022 - Photo © Claire Martin-Lucy
Origine supposée des noms
- générique : Papaver était déjà le nom latin du coquelicot, même si au XVe siècle on le disait rubeum plutôt que rubrum comme aurait pu le dire Linné. Les noms de couleurs en latin ont toute une histoire !
Le mot papaver lui a survécu dans le "pavot" français ou le "papoila" portugais ou même l'anglais "poppy". Les Hongrois nomment "pipacs" notre coquelicot. - spécifique : du latin rhoeăs,-ădis ou de rhoea,-ae, provenant eux-mêmes d'un dialecte antérieur, l'éolien (langue de Sappho), ῥοιάς (rhoiás) et d'un verbe rheo, je tombe, allusion à la chute précoce des pétales.
 Chant saphique pour violoncelle et piano, Op. 91 - Camille Saint-Saens Chant saphique pour violoncelle et piano, Op. 91 - Camille Saint-Saens
- Le coquelicot aurait été appelé "coquerico" en vieux français à cause de la couleur de sa fleur qui rappelait la crête du coq. Mais il a aussi porté le nom de "poncel" et sa belle couleur rouge celui de ponceau.
Détails caractéristiques
- Ses graines peuvent être susceptibles de germer pendant plusieurs dizaines d'années.
- Les feuilles inférieures de P. rhoeas, disposées en rosettes, apparaissent dès l'Automne bien avant sa tige hérissée de poils raides au Printemps.

Blannay, 3 décembre 2023 - Photo © Claire Martin-Lucy
- Ses feuilles ont des découpures très polymorphes et qui varient d'un individu à l'autre, sans oublier que durant son existence une plante à fleurs développe pratiquement toujours plusieurs types de feuilles.
- Ses boutons floraux dont la coque, hérissée de poils, peut inhabituellement se situer à proximité des feuilles, ce qui laisse supposer que son pédicelle devait être très court.

Blannay, 5 mai 2021 - Photo © Claire Martin-Lucy
- La préfloraison chiffonée de ses corolles protégées par un calice caduque.
- L'androcée est polystémone puisque ses étamines sont nombreuses. Leurs anthères produisent des grains de pollen qui ont des apertures à membrane ornementée et c'est dès très tôt le matin qu'ils attirent les insectes butineurs. Une seule de ses fleurs fournirait 2,6 millions de grains de pollen, selon Paul Jaeger.
- Styles et stigmates soudés forment ce qui est nommé un plateau stigmatique.
- Ses capsules globuleuses et glabres sont poricides. Elles contiennent des graines sans alcaloïdes toxiques (anthocyanosides dérivés du cyanidol qui en font une plante ayant des vertus thérapeutiques comme antitussif).

- Sa sève acide offre un milieu riche en ions hydrogène aux molécules de cyanidine de ses pétales qui prennent une couleur rouge en attrapant un de ces ions (Cf. Le parfum de la fraise, page 206) mais, réfléchissant fortement l'ultraviolet, ils sont d'un blanc éclatant pour les insectes butineurs qui n'ont pas nos yeux.
- La tache foncée à la base de ses pétales n'est pas toujours présente.


Séry, 23 juin 2011
|