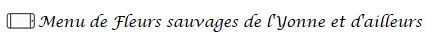Pétasite hybride,
chapeau du diable
Petasites hybridus
(L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb., 1801
Famille des Asteraceae (Compositae)
Tribu des Senecioneae - Sous-famille des Asteroideae
Ordre des Asterales
Clades des Campanulids / Asterids
/ Pentapetalae / Gunneridae / Eudicotyledons

| PETASITES hybridus (L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb. Pétasite hybride, chapeau du diable |
Dans l'Yonne
Origine supposée des noms
Synonymies connues
Détails caractéristiques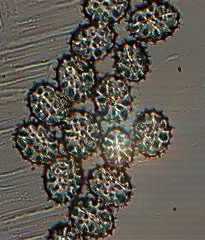
Généralités
Nombre d'espèces icaunaises dans le genre
|